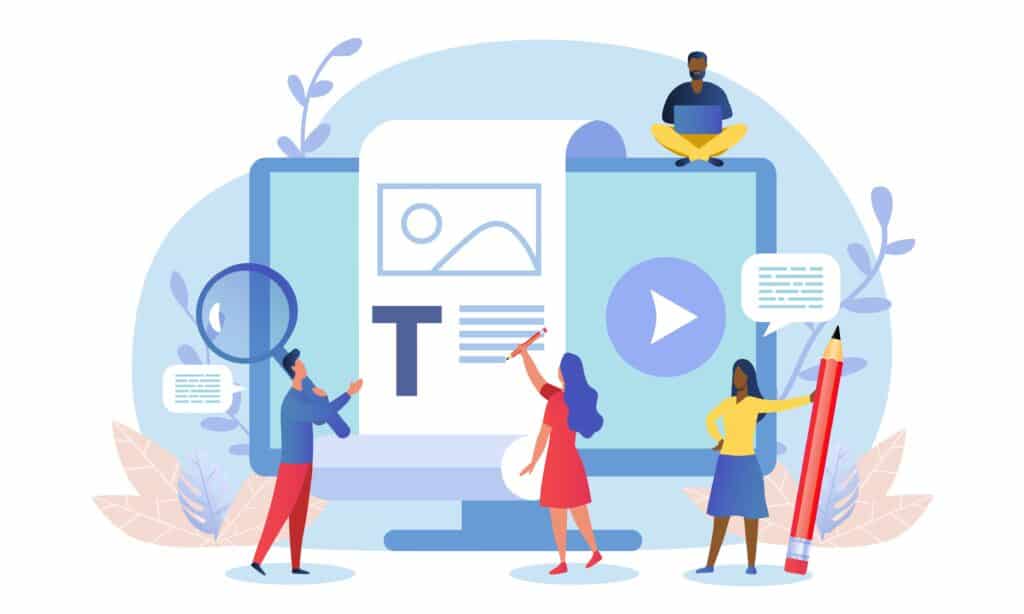J’aime écrire, j’aime les mots et depuis quelques temps, je me plais à suivre quelques instagrameurs qui décortiquent notre langage. Ça m’a amené à me demander d’où provient le terme même « Handicap », derrière lequel on range tant de situations différentes. Car vous le savez, je le sais, nous le savons : quand on prononce le mot « handicap », de multiples images surgissent qui ne sont pourtant pas toutes pertinentes. Des fauteuils roulants aux rampes d’accès, en passant par les sourires forcés, les raccourcis maladroits et surtout, les préjugés. Alors plongez avec moi dans les racines étymologiques et l’évolution de ce mot, pour mieux comprendre comment il en est venu à cristalliser des perceptions parfois limitantes et généralisées.
Un jeu de hasard, rien que ça…
Sans plus de suspense, sachez que le mot « handicap » tire son origine d’une expression anglaise du XVIIe siècle : « hand in cap », qui signifie « main dans le chapeau » (si si, je vous assure !) Mais alors c’est quoi le rapport ? Patience… C’était donc un jeu de troc au cours duquel deux joueurs échangeaient des objets devant un arbitre. Si l’un des objets était d’une valeur moins importante que l’autre, le joueur concerné ajoutait une somme d’argent dans un chapeau pour équilibrer. Les deux joueurs plaçaient ensuite chacun une main dans le chapeau et lorsqu’ils les ressortaient, si les deux étaient ouvertes, l’échange était validé, sinon il était annulé.
Ce n’est qu’au XIXe siècle que l’idée d’un « handicap » prend un autre sens. Dans le domaine des courses hippiques, le terme désigne un système visant à égaliser les chances entre chevaux de différents niveaux : les meilleurs chevaux portaient des poids supplémentaires. Progressivement, cette idée d’équilibrer les chances s’est appliquée aux personnes à mobilité réduite ou ayant des besoins spécifiques… Charmant n’est-ce pas ?
De l’égalisation à la limitation
L’adoption du mot « handicap » dans le champ médico-social date lui, du XXe siècle. Utilisé pour désigner les personnes ayant une déficience physique, mentale ou sensorielle, ce mot que j’utilise si souvent a initialement servi à classifier et diagnostiquer. Mais très vite, il a pris une connotation bien moins neutre en devenant un réducteur identitaire, voire une insulte.
En français, il n’y a pas d’équivalent précis au mot anglais « disability », qui renvoie à une perte ou une diminution de capacité fonctionnelle. Au lieu de cela, « handicap » englobe tout, des situations temporaires aux état permanents, gommant ainsi la complexité des expériences individuelles. De « personne handicapée » à « en situation de handicap », les tentatives de faire évoluer le langage trahissent une réalité : le mot reste connoté comme une étiquette figée, limitante, et souvent inexacte selon les points de vue.
Handicap : un seul mot pour bien trop de significations
Le principal problème avec le mot « handicap » est qu’il est souvent perçu comme une définition réductrice. Dire d’une personne qu’elle est « handicapée » revient trop souvent à la limiter à une seule caractéristique, effaçant ses talents, ses aspirations et ses identités multiples. Sans parler de toutes les fois où on l’utilise pour des situations pourtant bien différentes !
- Le handicap moteur comme difficultés physiques
- Les handicaps mental, sensoriel, psychique, etc. comme difficultés cognitives
- Le handicap d’une équipe comme désavantage de jeu
- Le handicap comme synonyme du mot « problème »
- Un handicapé comme insulte pour une personne étourdie ou maladroite
- etc.
Et si on changeait de lunettes ?

Et puis peut-être qu’à force de visibilité, de témoignages et de curiosité, les mentalités pourraient se modifier peu à peu et nous prendrions naturellement le pli d’inconsciemment valoriser les capacités d’une personne plutôt que de s’arrêter sur ce qu’elle ne peut pas faire. Quand j’étais valide, personne ne me considérait de façon étrange parce que je ne savais pas siffler ou réciter ma table de 9 : pourquoi est-ce le cas du fait que je ne marche pas ? Certes les conséquences ne sont pas les mêmes, mais pour qui cela pose-t-il vraiment problème dans la vie de tous les jours ? Moi, pas eux ni vous.
Un mot, mais pas une fin en soi
Au final, le mot « handicap » n’est qu’un point de départ. Il invite à faire preuve d’intelligence en allant au-delà d’où il nous emmène en première intention. Il faut explorer non seulement ce qu’il signifie, mais aussi ce qu’il ne devrait pas signifier : une case à cocher, une limite, ou une façon de définir quelqu’un. Peut-être qu’à l’avenir, nous trouverons un vocabulaire qui reflète mieux la richesse et la diversité des expériences humaines.